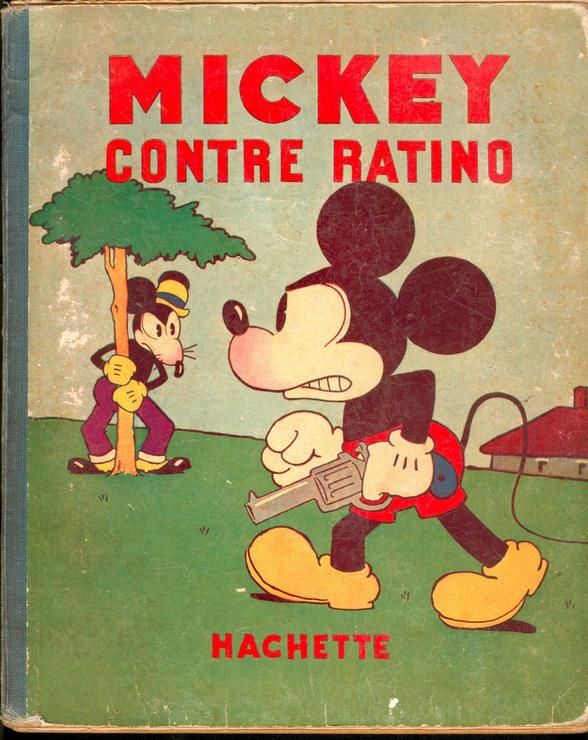Les Tuileries. Oubliez la majuscule, qui lie immédiatement ce nom à l'un des plus fameux et des plus anciens jardins parisiens. Oubliez aussi le palais des Tuileries que Marie de Médicis fit bâtir ici en même temps que le jardin, palais qui fut incendié en 1871, puis démoli, avant que ses vestiges ne soient dispersés à travers la France. Comme avec un palimpseste, grattez les couches historiques les unes après les autres, et revenez au sens premier des mots, que le temps a presque effacé: des tuileries, ce sont des fabriques de tuiles. Si le quartier porte ce nom, c'est qu'avant les jardins, avant les palais, il abritait plusieurs de ces fabriques.
Au moins trois. Elles furent créées au bord de la Seine, dans un endroit alors appelé la Sablonnière, où, de très longue date, on extrayait de l'argile rouge. On repère la trace de ces fabriques de poteries et de tuiles dès 1373. Dans le censier de l'évêché datant de cette année-là, les tuiliers Guillaume et Clément de Moncy, Gilles de Macy, Perrenelle de Crépon, Jehan Mandolle, Jehan de Boneil le Vieil travaillent dans ce lieu appelé Tuileries. Puis, dans des lettres patentes de Charles VI remontant au mois d'août 1426, ces tuileries sont dites situées "outre les fossez du château du bois du Louvre".
 |
| Vue cavalière du château des tuileries, du jardin et de la Seine (plan dit de Mérian, 1615) |
Ce n'étaient pas les seules, ni les premières tuileries parisiennes. « On trouve cités douze tuiliers dans la Taille de 1292, et neuf dans celle de 1300», précise Alfred Franklin dans son Dictionnaire historique des arts, métiers et professions exercés dans Paris depuis le treizième siècle (1906). Les tuiles étaient alors d'usage fréquent à Paris, contrairement aux ardoises, qui venaient de régions comme l'Anjou ou les Ardennes, et coûtaient donc plus cher.
En 1518, la maison dite "des Tuileries" est achetée à Nicolas de Neufville, seigneur de Villeroi, par le roi François Ier. Vers 1564, ne voulant plus habiter le château des Tournelles où son époux Henri II est mort à la suite d'un tournoi, Catherine de Médicis décide de se construire une nouvelle demeure. Elle achète toutes les terres de l'ancienne Sablonnière qui n'appartenaient pas encore à la maison royale, fait disparaître ce qui restait des fabriques, pour bâtir à la place un nouveau palais accompagné de magnifiques jardins.
L'installation de Catherine de Médicis aux Tuileries annonce, plus largement, la fin de la fabrication des tuiles dans l'enceinte de la ville. Quelques années plus tard, en novembre 1577, alors que le pouvoir tente d'éloigner les industries polluantes, un édit du roi Henri III met en avant « la salubrité de l'air de la ville de Paris » pour défendre « d'y faire doresnavant aucunes tuileries ». Quant aux fabriques qui y sont déjà sises, Sa Majesté demande qu'elles "soient transférées, par l'avis des officiers de police, après avoir ouï ceux qui y ont intérêt".
Les tuileries ont ainsi été chassées de Paris il y a plus de 400 ans. De cette histoire pré-industrielle, ne subsiste qu'un nom - mais quel nom : les Tuileries.